Agriculture et alimentation : quel modèle d'ici trente ans ?
Afin de porter une réflexion sur l’avenir de l'agriculture et l'alimentation, quoi de mieux que de comprendre le passé et d’analyser les évolutions. C’est le projet lancé par trois intercommunalités drômoises.

Quelle pourrait être l’alimentation et l’agriculture à l’horizon 2050 ? C’est la question que posent les communautés de communes du Val de Drôme (CCVD) en Biovallée, du Crestois-Pays de Saillans (CCCPS) et du Diois (CCD). Leur ambition consiste à faire émerger des pistes autour d’un modèle alimentaire et agricole pérenne, capable de s’adapter aux évolutions en tenant compte des ressources locales. Quatre visioconférences* (en février et mars) suivies d’ateliers (de mars à mai) serviront à élaborer un programme d'actions, à décliner sur l'ensemble de ce vaste territoire. Pour la première visioconférence, le 11 février, les organisateurs ont invité Bertrand Hervieu, sociologue spécialiste des questions rurales, président de l’Académie d’agriculture de France, et Nadège Garambois, ingénieure agronome et docteur d’AgroParisTech. Le premier est venu présenter les grandes tendances de l’évolution de l’agriculture, passées et actuelles ; la seconde en a analysé les dynamiques actuelles et leurs limites, pointant l’intérêt de développer de nouveaux modèles agricoles reposant davantage sur l’agroécologie. Leurs interventions ont été enrichies de témoignages locaux (voir encadré).
« Quatrième grande crise agricole »

L’agriculture « n’est plus dans un processus d’homogénéisation mais dans la multiplicité des itinéraires », a expliqué Bertrand Hervieu, sociologue spécialiste des questions rurales.
« Sur trois siècles, le secteur agricole a traversé trois crises profondes et s’en est toujours relevé », explique Bertrand Hervieu. Faisant référence aux disettes des 17e et 18e siècles puis aux difficultés d’assurer une couverture alimentaire en France après la Seconde guerre mondiale, « une volonté politique est née avec, chaque fois, des solutions de progrès, observe-t-il. Le modèle d’après-guerre a été une réussite économique, faisant de la France une grande puissance agricole. » Mais la décennie 1990-2000 en a révélé des failles : surproduction, maladie de la vache folle, chute du nombre d’agriculteurs, modèle familiale mis en difficulté, financiarisation de l’agriculture, concurrence mondiale… Suivront, dans les années 2000, les critiques d’une grande partie de la société, qui juge ce modèle peu vertueux au regard de l’environnement, de la santé... « Dans cette quatrième grande crise, le monde agricole prend conscience qu’il est une minorité (1,8 % de la population active française) et qu’il est plus compliqué de repenser des politiques publiques avec la multiplicité des interlocuteurs (consommateurs, associations environnementales, territoires…) », estime le sociologue.
« Multiplicité des itinéraires »
L’agriculture « n’est plus dans un processus d’homogénéisation mais dans la multiplicité des itinéraires », poursuit Bertrand Hervieu. L’éclatement du modèle agricole aboutit à une « tripolarité » qu’il résume ainsi : d’une part « l’exploitation familiale, spécialisée par bassins de production et très dépendante de l’aval, très fragilisée, notamment en lait et viande ». D’autre part, une « agriculture de firme, financiarisée et tournée vers les grands marchés ». Enfin, la « micro-entreprise, modèle porteur d’innovation, en phase avec les attentes de la société ». A l’heure de la transition agricole, « repenser un modèle, c’est prendre des risques de réorganisation de son capital, de son savoir-faire… Selon les âges, ce n’est pas évident, confie le sociologue. La démographie agricole actuelle, vieillissante, n’aide pas à faire cette transition. »
« Effondrement de la richesse créée »
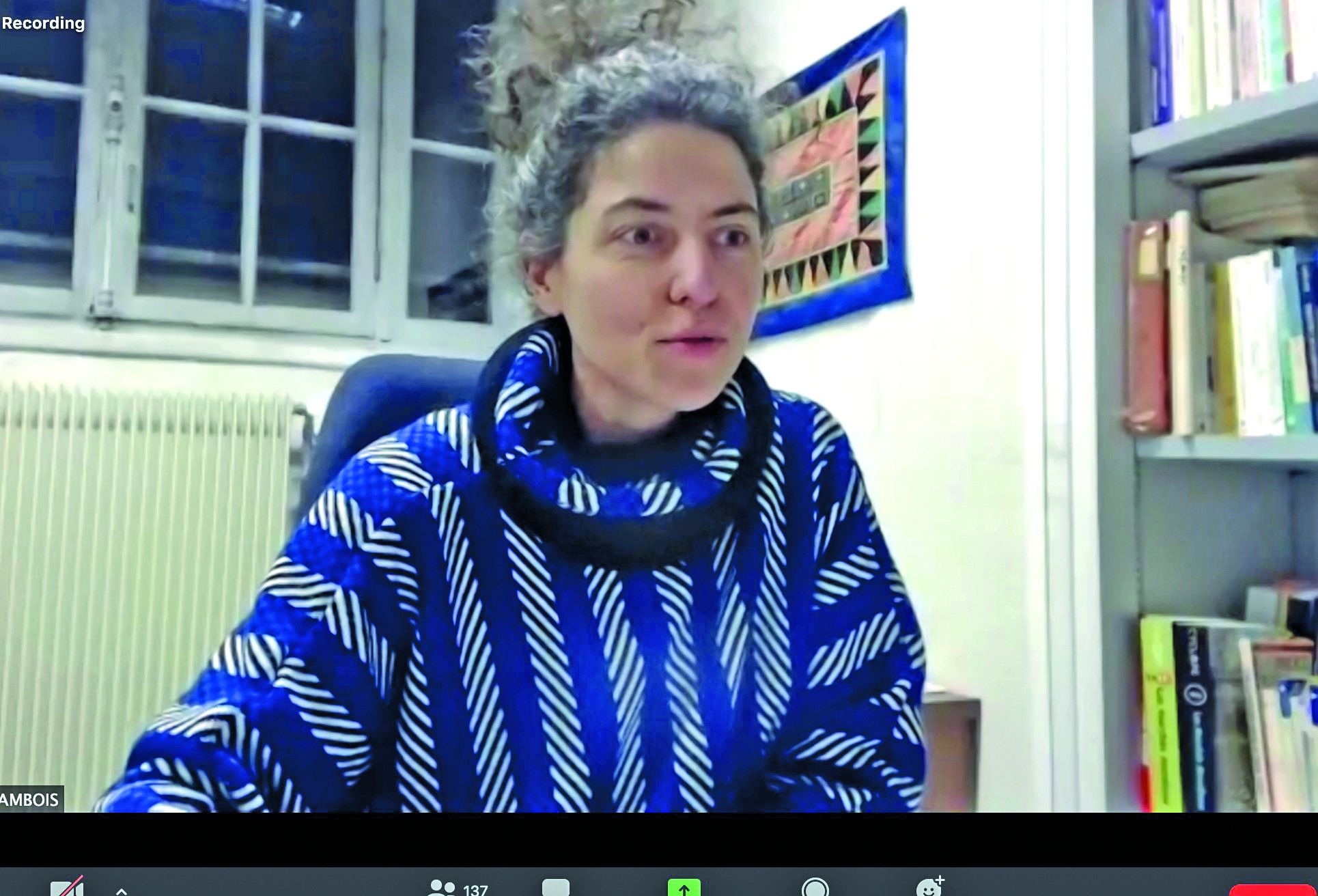
Nadège Garambois, ingénieure agronome et docteur d’AgroParisTech, a présenté les grandes tendances de l’évolution de l’agriculture, passées et actuelles, et analysé les dynamiques actuelles et leurs limites.
« Depuis les années 1950, le développement agricole est centré sur l’accroissement de la productivité physique du travail », explique Nadège Garambois, dont les recherches traitent des dynamiques agraires en France et notamment du développement de systèmes de production contribuant davantage au développement durable. Chiffres et graphiques à l’appui, elle montre les évolutions spectaculaires en termes de volumes produits par actif agricole, par hectare, par animal… mais aussi la réduction drastique du nombre des emplois agricoles, la spécialisation et l’agrandissement des exploitations. « Cela s’accompagne d’une évolution des prix relatifs en défaveur du secteur agricole avec une érosion régulière de la valeur ajoutée nette. Depuis les années 1970, on assiste à un effondrement de la richesse créée, résume-t-elle. Ce modèle de développement agricole de l’après-guerre pose une triple limite : économique, sociale et environnementale. »
Autre stratégie technique et économique
D’autres stratégies techniques et économiques existent et Nadège Garambois en a présenté plusieurs. Dans le bocage vendéen, un groupe a développé dans les années 1990 un système herbager économe. « Cela a conduit à ralentir l’érosion de la valeur ajoutée nette et à permettre un moindre agrandissement. » Dans le bassin de Lodève et Bédarieux (34), des agriculteurs ont réinvesti les espaces pastoraux ce qui s’est traduit « par un accroissement de la valeur ajoutée, renforcée par des débouchés locaux et une moindre dépendance aux subventions. » Dans le Vexin normand, en grandes cultures, l’émergence de systèmes agroécologiques a fait tomber l’indice de fréquence des traitements (IFT) à 1,8 (contre 5,2 auparavant). « Cela préfigure ce que pourrait devenir l’agriculture, conclut Nadège Garambois. Des modèles qui reposent davantage sur des processus biologiques et s’inscrivent dans un paradigme de développement qui met en avant la productivité économique du travail, quitte à modérer un peu les niveaux de rendements. »
Voilà de quoi alimenter la réflexion sur l’avenir de l'agriculture dans la vallée de la Drôme et le Diois. Des territoires, comme d’autres en Drôme, où l’évolution agricole est déjà en marche.
Christophe Ledoux
* Les trois prochaines visioconférences sont programmées les 26 février (alimentation et santé), 8 mars (écosystèmes) et 18 mars (changement climatique). Plus d’infos sur valdedrome.com
Le point de vue d'acteurs locaux
« Il ne faut jamais rester figé sur un modèle mais en comprendre les évolutions et les accompagner », confie Christian Veyrier, agriculteur et président de Valsoleil. La coopérative a anticipé les transformations sociétales en abandonnant l’œuf en cage il y a vingt ans au profit de l’œuf alternatif. « Par ailleurs, malgré la fermeture des marchés céréaliers méditerranéens après la percée des pays d’Europe centrale (Peco), nous avons su maintenir une production drômoise en développant l’aviculture localement », assure le président. « Notre rôle est de construire des filières en allant vers la valorisation, ajoute-t-il. Dans la Drôme, il y a déjà beaucoup de valeur ajoutée à l’hectare, donc peu d’évolution des exploitations ».
« En vingt ans, passant de 10 à 20 %, l’approvisionnement local a doublé, note Damien Loyal, pdg des Intermarchés d’Aouste-sur-Sye et Loriol. Bien qu’il faille pérenniser des partenariats locaux, le gros frein est celui de la logistique. Il faut mutualiser des moyens. » A l’idée de développer une plateforme logistique Biovallée, il répond : « Pourquoi pas ? ». Il note aussi que sur les plateformes d’achat en ligne des supermarchés, les produits locaux ont moins de visibilité car la gamme proposée est rationalisée sur des produits de masse. « Peut-être faudrait-il créer des sites dédiés aux produits locaux ? », propose-t-il.
« Il y a eu un effondrement de la valeur ajoutée agricole mais aussi un effondrement du budget alimentaire », fait remarquer Florent Dunoyer, directeur de l’épicerie bio coopérative La Carline, située à Die. Au sortir de la guerre, 40 % du revenu des ménages partait dans l’alimentation. Aujourd’hui, c’est moins de 15 %. C’est un vrai problème car il y a aujourd’hui une injonction pour les producteurs agricoles et autres acteurs de la filière de remettre de l’éthique, de l’humain, de la santé dans des conditions de marché qui ne bougent pas. Or les marges dans l’alimentaire sont faibles, autour de 25 %. Consommateurs et producteurs doivent se mettre ensemble pour réinvestir dans la valeur. » Par ailleurs, il considère que « la solution n’est pas que dans les petites structures, le bio et les circuits courts car il y a aussi de la vulnérabilité dans ces circuits-là. » Enfin, prônant les valeurs de la Scic*, « le système Carline permet de déconnecter la propriété de l’outil de production et l’usage. Il permet d’innover. »
C. L.
* Scic : société coopérative d'intérêt collectif.




